Quelques-unes des plus belles oeuvres du MOMA exposées à Paris pour notre plus grand bonheur. Superbe exposition!
.
Les chefs-d'oeuvre du MoMA de New York à la Fondation Vuitton
 Cindy Sherman : Untitled Film Still #21, 1978. Epreuve gélatino-argentique, 19,1 cm x 2,1. 2017 Cindy Sherman
Cindy Sherman : Untitled Film Still #21, 1978. Epreuve gélatino-argentique, 19,1 cm x 2,1. 2017 Cindy Sherman
Profitant des travaux du Moma de New York, la Fondation Vuitton, présente jusqu'au 05 mars 2018, une sélection des oeuvres importantes du Musée d'Art Moderne de New York. Cet établissement artistique mondialement connu et très aimé des français, a toujours voulu témoigner de l'évolution de la société et de l'histoire de l'art du XXe siècle. Cette exposition est l'occasion d'admirer des chefs-d'oeuvre connus de tous, elle propose aussi un bon aperçu de l'art américian, après la seconde guerre mondiale. Visite.
A chaque fois que je pénètre dans la Fondation Vuitton, réalisée par l’architecte Franck Gehry, j’ai l’impression de rentrer dans un trois mats de luxe, pour un long voyage. Cette fois-ci, le périple artistique me mène vers les Etats-Unis. En effet, en collaboration avec le Museum of Modern Art New York, la Fondation Vuitton expose de nombreux chefs-d’œuvre du célèbre MoMA. Je vais enfin voir le Baigneur de Cézanne, des Picasso, L’oiseau de Brancusi et même la première apparition de Mickey par Walt Disney. Les organisateurs ont également voulu accrocher des artistes moins connus, mais qui participent tous à la démarche du musée, bien particulière. Elle explique le titre de cette présentation exceptionnelle : « Etre moderne : le MoMA à Paris ». La liste des artistes est impressionnante. Je ne suis pas sûr qu le grand public français, connaisse Elworth Kelly, peintre américain minimaliste mort en 2015, à l'âge de 92 ans. Toute sa vie, il s'est intéressé à l'équilbre des lignes et des couleurs. J'observe ce collage de carrés découpés, dans des feuilles de papier de couleur. Ce travail témoigne de la volonté profonde de Kelly, de réaliser un art abstrait et anonyme. L'artiste se serait inspiré du jeu de la lumière sur la Seine, quand il habitait à Paris dans l'ïle Saint Louis, où il est resté près de six ans, de 1948 à 1954.

Ellworth Kelly : Couleurs pour un grand mur, 1951. Huile sur panneaux, dimenssions totales : 240 cm x 240. 2017 The estate of Ellworth Kelly
La torpille MoMA
Depuis sa création en 1929, le MoMA a toujours voulu être novateur. Dès 1932, le musée affiche son envie de modernité en proposant la première exposition sur l’architecture (Modern Architecture : International). Deux ans plus tard, il organise une présentation consacrée au design. En 1936, le public new yorkais découvre sa grande exposition sur le cubisme et l’art abstrait. L’année suivante, le musée propose une rétrospective sur la photographie de 1839 à 1937. Il ne s’arrête pas là, en 1957, le monde découvre une immense rétrospective Picasso. En 1970, le MoMA innove encore en présentant des films, en lien avec les questions sociales (What’s Happening). En 1971, c’est la création du « département des Dessins ». Le MoMA est aussi le premier musée à établir un inventaire numérique de ses collections. Le temple américain de l’art, n’a jamais cessé d’aller de l’avant. Son premier directeur, Alfred H Barr, se montre dès le début, un ardent défenseur d’une politique pluridisciplinaire. Afred H Barr, évoque souvent l’image d’une torpille : il rêve d’un musée toujours en mouvement, qui qui déchire le ciel du quotidien et laisse une trace derrière elle. Mais dès le début, les américains reprochent au MoMa d’offrir des expositions trop européennes, trop internationales. L’ouverture d’esprit de Barr, et de ses successeurs, n’est pas comprise par tous... Aujourd'hui, les français sont les plus nombreux à visiter le Moma. Présenter les collections du musée au bois de Boulogne est donc, d'une certaine façon, un juste retour des choses.
Pop Art
Je passe le portique de sécurité, sous l’œil très attentif d’un agent de sécurité. J’ai l’impression d’être dans un aéroport. La marque de luxe ne blague pas avec la sécurité, c’est rassurant. Je me glisse dans la grande porte tournante. Je m’attends à une présentation très officielle avec beaucoup de longs discours, plus ou moins ennuyeux. Mais rien de tout cela, les quelques journalistes présents sont invités à une visite libre. La première œuvre que j’aperçois est un grand dessin de Mies van der Rohe , le célèbre architecte. Commencer l’’exposition par cela est une façon de souligner l’éclectisme, toujours revendiqué par le musée. Cette œuvre représente un bâtiment de bureau à Berlin. A côté : cette grande toile de Roy Lichtenstein, roi du Pop art. En 1963, Lichtenstein réalise plusieurs tableaux directement inspirés de la bande dessinée. Une bulle de BD devient, sous son pinceau, une grande toile. Pour acquérir ce tableau, le musée a vendu un autre Lichtenstein, en sa possession. C’est un bon exemple d’une politique voulue par Alfred H Barr : ne pas hésiter à se "débarrasser" d’une œuvre, pour en acquérir une autre. Cette femme au milieu des vagues en est une parfaite illustration.

Roy Lichtenstein : Fille qui se noie, 1963. Huile et peinture acrylique sur toile, 171,6 cm x 169,5. Estate of Roy Lichtenstein New York / ADAGP, Paris 2017
Petites boîtes et grand artiste
Au fond de la salle, il est impossible de les manquer. 32 petites toiles d’Andy Warhol représentant les fameuses boites de soupe Cambell’s. L’image aurait été, à chaque fois, reproduite au pochoir. Cette soupe était présente dans chaque supermarché des Etats Unis. Ces boîtes sont la parfaite illustration de la culture du quotidien, que les sociologues appellent culture de masse. Je les regarde de près, de loin. Outre leur contenu symbolique d’une critique de la société de consommation et d’une volonté d’élever le banal au rang d' œuvre d’art, j’ai honte de le dire, mais ces travaux me laissent froid comme un vieux potage oublié dans un frigo. Là, je ne vais pas me faire des amis mais puisque c’est ce que j’ai ressenti, je le dis. Bien sûr, derrière l’apparence, il y a des différences remarquables d’une peinture à l’autre. Mais je dois bien avouer que "Cambell's Soup" a propulsé le Pop Art dans les bras des médias et que ce mouvement artistique est devenu un des plus importants de l'art américain. Mon œil est beaucoup plus attiré par un double Elvis Presley, sur fond argenté. En 1963, Warhol réalise trente toiles sur ce thème. L’œuvre est inspirée par une photo publicitaire, pour un western. C’est pourquoi le chanteur pointe une arme. L’artiste en superposant deux images, rend hommage au cinéma. On retrouve, dans ce travail, le saut d’images caractéristique d’une projection de film. Andy Warhol a offert cette toile à Bob Dylan mais le chanteur aurait donné l’œuvre à son manager, en échange d’un canapé… En 2001, elle rentre au MoMa, donnée par un collectionneur.

Andy Warhol : Double Elvis, 1963. Encre sérigraphique et peinture acrylique sur toile, 210,8 cm x 134,6. The andy Warhol Foundation for the Visual arts, Inc / Adagp, Paris 2017
Musique et technique
Elle est là, face à moi, c’est une icône de la musique et du design du XXe siècle : la guitare de Leo Fender et de l’ingénieur Georges Fullenton, la Stratocaster 1954. Je continue ma visite, toute la fondation est consacrée à l’exposition. Le sol est gris, les murs crème. Avec une pareille scénographie, on est sûr de ne pas se tromper…
Le mystère Hopper
La première œuvre qui est rentré au Moma dès sa création en 1929, est un petit tableau d’Edward Hopper : maison près de la voie ferrée. Le peintre situe l’œil de l’observateur sous les rails, c’est très surprenant. La maison prend alors une ampleur considérable et ressemble à une sorte de monstre. Deux rideaux à demi baissés, au premier étage, renforce encore l’impression d’angoisse et de mystère.
Premier long métrage de l’histoire du cinéma et liberté en forme d’oiseau
Je prends l’escalator. A l’intérieur de la Fondation, j’ai un peu l’impression de me retrouver dans un temple égyptien. L’exposition propose le premier long métrage, daté de 1913. En pleine période de ségrégation, T. Hayes Hunter filme, en noir et blanc, la sortie d’une boîte de nuit fictive, avec beaucoup d’acteurs noirs dans son casting. Le film s’intitule « Sortie du Lime Kiln club ». Face à ses comédiens qui défilent sur l’écran, l’oiseau de Brancusi, symbole de liberté, a pris place sur un haut socle blanc. Je tourne autour. Il me semble évident que ce n’est pas un volatile qu’a voulu faire le sculpteur, mais l’idée d’un oiseau, le sentiment de liberté aussi. L’œuvre se dresse avec fierté comme une flamme, elle possède une grâce infinie.

Constantin Brancusi : Oiseau dans l'espace, 1928. Bronze, 137,2 cm x 28,6. succession Brancusi-All rights reserved (Adagp), 2017
Mickey sur un bateau
Sur un grand écran, je regarde la première apparition de Mickey, un film datant de 1928. Et Mickey bénéficie même d'une bande son synchronisée. En 1935, la première conservatrice spécialisée dans le cinéma, Iris Barry, étonne en prétendant que les films doivent être gardés dans les musées. Un an plus tard, le Mickey de Walt Disney entre au Moma. L’humour de Walt Disney n’a pas vieilli. La joie de vivre impertinente de la petite souris est immortelle.
Un beau baigneur
Ah le voilà, le fameux « Baigneur » de Cézanne. C’est un homme debout, les pieds dans l’eau, devant un paysage quasi abstrait. Il entre dans les collections du Museum of Modern Art en 1934. En le regardant, ne serait-ce qu’une seconde, on comprend tout de suite ce que Picasso doit à Cézanne. Je m’approche pour le regarder en détail. Comme toujours chez Cézanne, le corps est très architecturé. La jambe gauche est en avant. Le peintre a souligné la musculature du jeune homme. Le fond est composé d'une multitude de nuances de gris-bleu. De tout côté, c’est un tableau résolument moderne, précurseur. Oui, Cézanne est bien le père de l'art contemporain.

Paul Cézanne : Le baigneur, vers 1885. Huile sur toile, 127 cm x 96,8. The museum of Modern Art, New York. Collection Lillie P. Bliss, 1934
L’héritage de Cézanne
Je tourne la tête et j’ai la preuve de ce que j’avance. J’observe un magnifique Picasso : Jeune garçon au cheval (1905-1906). Les points communs avec Cézanne ne se comptent plus : même arrondi du haut du visage, même jambe en avant, même sensualité du personnage, même nuances de gris, pour une partie de l’arrière-plan. C’est impressionnant. Ces deux tableaux sont des chefs d’œuvre. Pourtant, ce tableau de Picasso est en fait une étude pour une toile qui n’a jamais vu le jour : L’Abreuvoir.
Psychédélique
Cette toile de Signac est étonnante à plus d’un titre. Le personnage ressemble à un papillon, posé sur une fleur exubérante. C’est le portrait d‘un ami de l’artiste, le critique d’art et activiste politique Félix Féneon, reconnaissable à sa barbichette qui serait très tendance aujourd’hui. Il tend une fleur de Lys à une personne qu’on ne voit pas. J’ai l’impression que le personnage est en mouvement, mais il paraît immobile : curieux. Le tourbillon des motifs en arrière plan et la technique du pointillisme, renforcent un étrange effet optique, presque psychédélique avant l’heure.

Paul Signac : Sur l'émail d'un fond rythmique de mesures et d'angles, de tons et de teintes, portrait de M. Félix Fénéon en 1890, opus 217, 1890. Huile sur toile, 7",5 cm x 9é,5. The Museum of Modern art, New York. Don de M et Mme David Rockefeller, 1991.
L’étrange beauté de Klimt
Et ça continue. Face à moi un superbe Klimt. C’est une œuvre style art nouveau, dans lequel les personnages et les éléments décoratif colorés, se confondent avec une grande subtilité. La toile représente une femme enceinte, seins nus. En bas trois silhouettes féminines lèvent les bras en signe d’incantation. Ce tableau représente donc la vie, mais aussi la mort...
Potemkine et les Demoiselle d ‘Avignon
Je reste quelques instants à regarder un extrait du film Potemkine de Serguei Eisenstein, la célèbre scène de l’escalier, dans laquelle un bébé dans son landau dévale les marches sous le regard terrifié de sa mère. La salle suivante présente photos et dessins retraçant l’histoire des vernissages du MoMA. J’observe un cliché, pris lors de l’acquisition des « Demoiselles d’Avignon » de Picasso, en 1939. Dans une vitrine, je regarde une cravate peinte par Picasso et offerte à Alfred H Barr.
La spiritualité de Rothko
Je passe dans une autre salle et tombe nez à nez avec un Rothko : mystérieux, spirituel, coloré. Chez ce peintre, la couleur bat comme un cœur humain et la lumière vibre comme une bougie derrière une feuille de papier calque : c’est incroyablement beau et profond.
Les néons et nous
Cette sculpture aux néons de Bruce Nauman, né en 1941, comporte six mots : Humain, Espoir, Besoin, Rêve et Désir : tout un programme… Chaque mot est d’une couleur différente. Lorsqu’il était étudiant à San Francisco, Nauman habitait dans une ancienne épicerie. Celle-ci comportait une enseigne. L’artiste la regarde souvent. En 1965, il commence à travailler avec des tubes néons. Cette œuvre a été offerte au MoMA en 1991, par un collectionneur.

Bruce Nauman : Humain, Besoin, Désir, 1983. Tubes de néons et fils éléctriques, cadres de suspension en tube de verre. Adagp, Paris 2017
Nuages photographiques
Je jette un coup d’œil à quelques photos de nuages d’Alfred Stieglitz, le promoteur de la photographie considérée comme un œuvre d’art à part entière. Ce photographe a réalisé des centaines de clichés de nuages, tous plus beaux les uns que les autres.
Peinture à la pipette
Je reste en pâmoison devant un grand tableau de Jackson Pollock. Pour cette œuvre, Pollock laisse tomber sa technique du dripping, danse autour du tableau avec une boîte de conserve trouée ou jets de couleurs. Ici, il peint à la pipette sur une toile beige non préparée. Parfois, j’ai l’impression d’apercevoir des formes figuratives. Je suis totalement séduis par ce tableau, à part, dans l’art de Pollock. il me rappelle les débuts du peintre.
Voir les chefs-d’œuvre du musée de New York, à Paris, est très rare. Ne ratez pas cette occasion. Cette exposition, oh combien éclectique, est un véritable régal pour l’esprit et les yeux. Je n’ai pas pu citer tous les artistes, il y en a tellement…
Fondation Vuitton : 8 avenue du Mahatma Ghandi, 75116 Paris


/https%3A%2F%2Fstorage.canalblog.com%2F65%2F96%2F631816%2F113233878_o.jpg)
/https%3A%2F%2Fstorage.canalblog.com%2F32%2F94%2F631816%2F76250194_o.jpg)
/https%3A%2F%2Fstorage.canalblog.com%2F60%2F35%2F631816%2F62142216_o.jpg)




















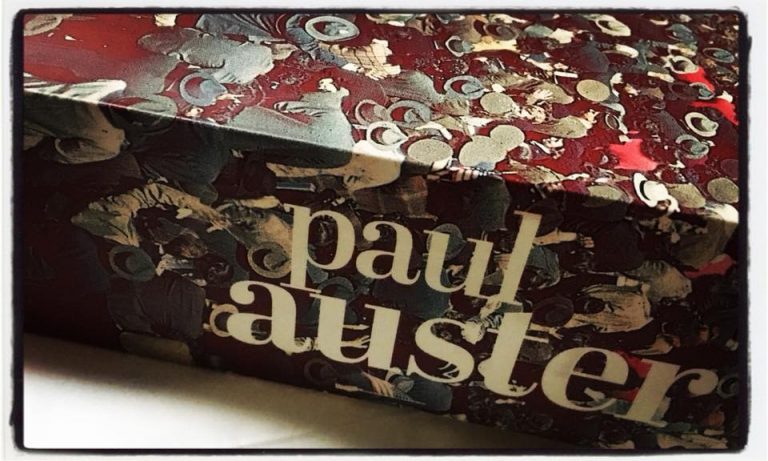


 Cindy Sherman : Untitled Film Still #21, 1978. Epreuve gélatino-argentique, 19,1 cm x 2,1. 2017 Cindy Sherman
Cindy Sherman : Untitled Film Still #21, 1978. Epreuve gélatino-argentique, 19,1 cm x 2,1. 2017 Cindy Sherman






